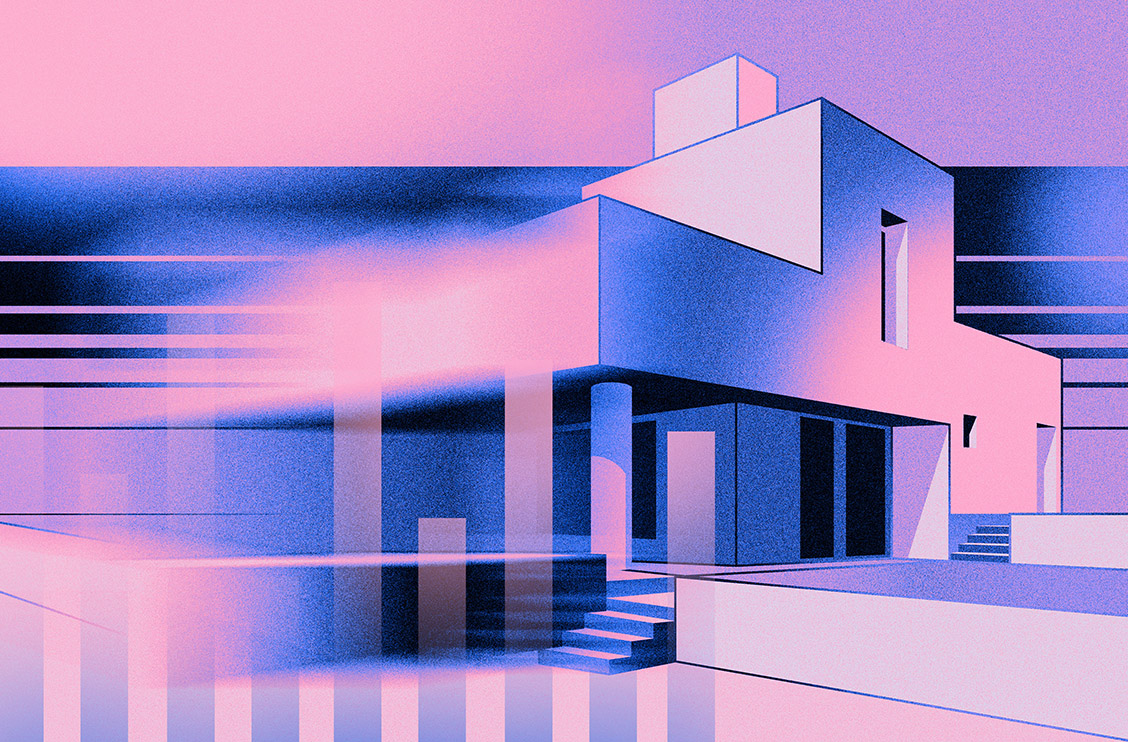
Cet article analyse les développements récents et perspectives sur le marché de la construction neuve, du logement ancien et des logements locatifs.
Le marché de la construction neuve en France reste en net repli début 2025, malgré une légère détente des coûts et des taux d’intérêt. La demande demeure fragile, les autorisations de construire à un niveau historiquement bas, et les effets des politiques publiques tardent à produire des résultats tangibles. Si certains territoires se démarquent par des dynamiques locales positives, aucun signal fort de redémarrage n’est encore observable à l’échelle nationale.
Le marché du neuf est dans l’impasse économique depuis plusieurs années, avec une activité de la construction fortement contractée. Le secteur a subi un double renchérissement : d'une part, la hausse des coûts de construction liée à l'inflation des matériaux, aux nouvelles normes environnementales (RE2020), et à la tension sur les chantiers (pénurie de main d’œuvre, difficultés d’approvisionnement et délais, multiplication des faillites d’entreprises du bâtiment) ; d'autre part, un resserrement brutal des conditions d'accès au crédit immobilier à partir de 2022. Ces facteurs ont entraîné un recul de la demande de logements neufs, lui-même à l'origine d'une chute historique de l'activité. Ainsi, en 2024, seuls 331 465 logements ont été autorisés à la construction (figure 2), soit la valeur la plus faible des 10 dernières années.
Au 4e trimestre 2024, les coûts de construction ont amorcé une relative détente, portée notamment par la baisse progressive des prix de l’énergie entamée au printemps. L’indice du coût de construction a ainsi reculé de 2,5 % sur un an, mais reste néanmoins près de 20 % au-dessus de son niveau de fin 2019 (figure 1). Parallèlement, la baisse des taux d'intérêt engagée au second semestre pourrait en théorie soutenir la demande. Toutefois, cette reprise potentielle est freinée par la fin du dispositif Pinel (arrêté au 31 décembre 2024), qui limite les incitations à l'investissement locatif. L'enquête de conjoncture dans la promotion immobilière publiée par l'Insee confirme cette situation : au 2e trimestre 2025, le solde d'opinion des promoteurs sur la demande de logements neufs reste négatif à –29,7 %. Cela représente certes une hausse remarquable par rapport aux –53,1 % enregistrés un an plus tôt, mais demeure toutefois bien en deçà de la moyenne des dix dernières années. La demande reste donc fragile, malgré une stabilisation des prix des logements neufs (+0,4 % sur un an au 4e trimestre 2024, +0,2 % en évolution trimestrielle, voir figure 1).
Conséquence : l'activité de construction reste en repli. On observe certes un très léger rebond des permis de construire au 1er trimestre 2025 (+1,2 % par rapport à la même période de l’année précédente), mais il ne saurait être interprété comme un redémarrage durable du marché. D'autant que les coûts de construction pourraient être affectés par l'incertitude géopolitique et commerciale internationale, notamment de potentielles hausses de droits de douane américains sur les matériaux importés.
La tendance nationale masque des réalités très hétérogènes (figure 3). En 2024, près de trois quarts des départements français ont vu baisser le nombre de logements autorisés. Plus de la moitié d'entre eux affichent un recul supérieur à la moyenne nationale de –12,5 %. Seuls 26 départements ont été épargnés. Parmi ceux qui se distinguent : les Pyrénées-Atlantiques (évolution de l’activité de construction sur 1 an : +5,6 %, taux de construction de 7,6 logements pour 1 000 habitants), l’Ain (+9 %, taux de 8,7), les Hauts-de-Seine (+7,5 %, taux de 6,6), le Val-de-Marne (+15,9 %, taux de 7,4) et la Haute-Corse (+7 %, taux de 13,5).
À Paris, la croissance spectaculaire de 123 % entre 2023 et 2024 reste exceptionnelle : le département partait d'un niveau historiquement bas (5 fois moins de logements construits que la moyenne nationale de 6,5 logements pour 1 000 habitants en moyenne sur la période 2019–2023). La Ville de Paris déploie une politique du logement volontariste pour augmenter l'offre de logements, notamment sociaux, afin de répondre à la demande croissante. Les objectifs fixés sont ambitieux : 25 500 logements sociaux supplémentaires entre 2023 et 2028, pour un parc existant de 269 080 logements sociaux (soit 25,5 % des résidences principales) et 277 000 ménages en attente de logements sociaux.
Certaines zones ont été par ailleurs retenues dans le programme national des 22 « territoires engagés pour le logement », lancé en 2023 par le gouvernement. Cette initiative vise à stimuler la production de logements dans des zones frappées par la pénurie grâce à une mobilisation coordonnée entre l'État et les collectivités locales, des mesures de simplification des procédures d'urbanisme (par exemple la réduction des délais d'obtention des permis de construire) et une priorité donnée au logement abordable et social.
La commune de Ferney-Voltaire (Ain) a par exemple été choisie en 2024 pour développer des projets immobiliers afin de pallier le manque de logements dans le Pays de Gex, zone frontalière de Genève. Ainsi, les 2 890 logements prévus à la construction vont pouvoir apporter une bouffée d’air à son parc de 6 285 logements (état 2020). De façon similaire, la Communauté d'agglomération du Pays Basque est un territoire des Pyrénées-Atlantiques, composé de 11 communes qui font face à une forte pression immobilière, notamment sur le littoral (comme dans les villes de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz). Les 3 500 logements prévus sur trois ans devraient contribuer à détendre un marché asséché dont seulement 4,7 % du parc est vacant (avec des taux encore plus bas pour Biarritz, 1,7 % et Saint-Jean-de-Luz, 3 %, contre 8,1 % en moyenne nationale). Cette initiative permettrait de doubler quasiment l’offre de logements et espérer répondre à la forte demande de logements dans ce territoire. Finalement, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a été sélectionné pour intensifier la production de logements sur son territoire du Val-de-Marne, où plusieurs projets d'aménagement sont en cours.
En 2024, le gouvernement a déployé plusieurs mesures pour soutenir l’offre de logements en agissant sur plusieurs leviers comme la simplification des procédures d’autorisations, la prolongation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’en 2027 avec des plafonds de revenus relevés pour rendre plus de ménages éligibles et la réforme de MaPrimeRénov’ pour inclure les mono-gestes (dans l’espoir d’améliorer la qualité du parc et de faciliter la réhabilitation et la remise sur le marché de logements vétustes). Cependant, les effets restent encore peu perceptibles : les permis de construire demeurent à un niveau historiquement bas, et les initiatives locales — comme l’objectif des 35 000 logements construits dans les 22 « territoires engagés » d’ici 2027 — apparaissent encore insuffisantes à l’échelle nationale.
Enfin, le contexte politique et géopolitique fragilise la visibilité à moyen terme : la priorité budgétaire donnée à la défense selon la volonté de l’Europe et les incertitudes politiques internes apparues à l'été 2024 dans un contexte de tension budgétaire ont contribué à reléguer la politique du logement au second plan. En dépit d'une légère amélioration de certains indicateurs, le marché de la construction reste déprimé en ce début 2025, et aucune reprise franche ne se profile sans relance structurelle.
En 2024, le marché résidentiel de l’ancien a amorcé une phase de stabilisation, après la forte contraction de l’activité observée en 2023. Ce rééquilibrage s’explique principalement par le repli des taux d’intérêt et l’amélioration progressive des conditions d’emprunt, malgré les incertitudes politiques et budgétaires de l’été 2024, qui ont pu inciter certains acquéreurs à la prudence.
Après une année 2023 marquée par un fort ralentissement dû à la hausse des taux, le marché de l’ancien a atteint son point d’atterrissage en 2024. Certes, la baisse du nombre de transactions s’est poursuivie au cours du premier semestre 2024, mais l’annonce des quatre baisses consécutives des taux directeurs par la BCE, de juin à décembre 2024, a permis d’enrayer cette chute. Ainsi, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois est estimé à 880 000 à la fin mars 2025 (chiffres provisoires de l’Insee), en hausse par rapport aux 845 000 de décembre 2024 et aux 832 000 de septembre 2024 selon la série révisée. Cette évolution confirme une reprise progressive du volume annuel de transactions amorcée en octobre 2024, après une phase de repli ininterrompue de huit trimestres (figures 4a et 4b). Néanmoins, nous sommes encore loin du record historique de 1 251 000 transactions atteint en août 2021, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Au total, le volume des ventes a chuté de 30 % depuis ce pic.
Les prix de transaction des logements anciens ont poursuivi leur recul en 2024 (figures 5 et 6). Cependant, avec la stabilisation des ventes observée en 2024, ce recul des prix s’est ralenti en fin d’année : à l’échelle nationale, on enregistre entre le 4ᵉ trimestre 2023 et le 4ᵉ trimestre 2024 une diminution de 1,8 % pour les appartements et de 2,2 % pour les maisons — des chiffres bien moins marqués qu’au début de l’année (respectivement -5,5 % et -4,9 % sur un an au 1er trimestre 2024). Le creux de la vague semble désormais passé : au 1er trimestre 2025, les prix enregistrent une légère hausse, de +0,3 % pour les maisons et +0,6 % pour les appartements, après six trimestres consécutifs de repli.
Grâce à la baisse des taux et des prix immobiliers, les ménages ont retrouvé du pouvoir d’achat immobilier, après une période de forte dégradation depuis 2021. En effet, avec la hausse rapide des taux d’intérêt entre décembre 2021 et décembre 2023, le coût d’accession à la propriété s’était accru de 37 % (voir encadré méthodologique). Or, depuis décembre 2023, les taux fixes à 20 ans, selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA, ont baissé de 125 points de base, atteignant 3,01 % en mars 2025. En parallèle, les prix ont baissé de 1,2 % en moyenne. Ces deux facteurs ont permis de réduire les coûts annuels de financement de 12 %, améliorant significativement la capacité d’achat immobilière.
La phase d’atterrissage des prix immobiliers a été particulièrement visible en Île-de-France, fortement touchée par le cycle baissier de 2023. Ainsi, entre le 4e trimestre 2022 et le 4e trimestre 2024, les prix des appartements y ont chuté de 9,7 % et ceux des maisons de 11,5 %. La Province a mieux résisté : -3,1 % pour les appartements et -5,1 % pour les maisons sur la même période (figures 5 et 6). En effet, les prix plus abordables en Province ont permis à une partie de la demande de se maintenir, malgré la hausse des taux.
Au 1er trimestre 2025 la reprise se confirme avant tout en province, où les appartements gagnent 1,1 % et les maisons 0,5 %, tandis qu’en Île-de-France, les prix des maisons reculent encore de 1,1 % et ceux des appartements progressent timidement (+0,4 %), signe d’un marché francilien encore fragile. Les appartements franciliens bénéficient néanmoins d’une meilleure dynamique. D’une part, la baisse des taux engagée au second semestre 2024 a permis à de nombreux ménages franciliens d’améliorer leur capacité d’emprunt, notamment pour l’achat d’appartements. D’autre part, la pénurie d’offre sur le marché locatif a pu déplacer une partie de la demande vers l’acquisition d’appartements.
En ce printemps 2025, le repli lent et modéré des prix des logements anciens observé en fin d’année 2024 a cédé la place à des hausses, parfois rapides, dans certaines grandes villes comme Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse, où les prix des appartements affichent des croissances à deux chiffres sur cinq ans (+27 % par exemple pour Marseille, figure 7). Ces villes, prisées pour leur qualité de vie par les secundo-accédants et les retraités au fort patrimoine, constituent des micromarchés peu affectés par le cycle de resserrement du crédit. À la fin du 1ᵉʳ trimestre 2025, Lyon et Nantes ont également vu leurs prix augmenter sur un an, retrouvant les niveaux de mars 2020.
À l’inverse, Paris (-7 %) et Bordeaux (-3 %) restent en deçà de leurs prix d’il y a cinq ans. Depuis 2010, la métropole bordelaise a vu sa population croître significativement, portée par une forte attractivité liée à sa qualité de vie, mais aussi par la mise en service de la ligne de train LGV en 2017, réduisant le temps de trajet entre Paris et Bordeaux à deux heures seulement. Cette dynamique s’est intensifiée après la pandémie de 2020, avec l’essor du télétravail qui a permis à de nombreux Franciliens de s’offrir des maisons avec des espaces extérieurs dans un cadre de vie plus vert et à des prix bien plus accessibles (43 % inférieurs à ceux de Paris, voir figure 7). Cette pression démographique a alimenté une forte hausse des prix de l’immobilier bordelais entre 2015 et 2022 (+50 % en 8 ans). Mais depuis, le marché a subi une correction des prix, en réponse à des taux d’intérêts élevés et à une demande en baisse, avant de se stabiliser au début de 2025.
L’accès au crédit, toujours difficile, a particulièrement pénalisé Paris, la ville la plus chère du classement. Toutefois, au 1er trimestre 2025, les prix au m² des appartements y dépassent à nouveau les 10 000 euros, alors qu’ils étaient passés en dessous de ce seuil en février 2024 selon la Fédération Nationale de l'Immobilier (Fnaim). Ce rebond peut s’expliquer par l’effet Jeux Olympiques, qui ont permis à Paris et à l’Île-de-France de bénéficier d’investissements massifs et d’améliorations notables des infrastructures – notamment avec le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à Saint-Denis – ainsi que par le développement du village olympique, qui ouvre de nouvelles opportunités d’achat et de location.
En résumé, l’année 2024 a été marquée par une baisse des prix immobiliers en France, affectant maisons et appartements, avec d’importantes disparités régionales. Toutefois, des signes de stabilisation sont apparus en fin d’année, à la faveur des baisses de taux successives décidées par la BCE depuis juin 2024, et une légère tendance à la hausse est déjà perceptible au début de 2025.
Néanmoins, la prudence reste de mise : d’une part, l’économie française fait preuve de peu de dynamisme - la croissance devrait rester sous la barre des 1 % cette année encore, tandis que l’emploi connaît une quasi-stagnation. À cela s’ajoutent les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques et aux répercussions de la politique économique américaine, qui renforcent le climat d’incertitude. D’autre part, les taux d’emprunt à long terme ne baissent plus – pour un prêt à taux fixe sur 20 ans, le taux moyen était de 3,04 % en avril 2025 contre 3,01 % en mars. Ainsi, malgré les baisses successives des taux directeurs, les taux à long terme se stabilisent désormais. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la hausse des droits de mutation à titre onéreux, votée en 2024 par une majorité de départements, risque de fragiliser la reprise. Cette mesure renchérit le coût d’achat immobilier, ce qui pourrait ralentir les transactions, en particulier chez les ménages modestes.
Néanmoins, dans un contexte de marché locatif saturé, la propriété gagne en attractivité face à la location dans de nombreuses villes et départements de France (voir l’étude « Vaut-il mieux acheter ou louer son logement en 2025 ? » ). Et les turbulences boursières du début d’année pourraient renforcer l’attrait de la pierre, vue comme un investissement stable. Face à ce contexte, nous prévoyons une augmentation modérée des prix des appartements et des maisons en France en 2025, avec des hausses moyennes annuelles attendues entre 1,5 % et 2 % pour les deux segments.
Le redémarrage du marché s’annonce plus timide dans les zones où le pouvoir d’achat immobilier est le plus contraint. C’est notamment le cas des départements d’Île-de-France, de la Savoie, de la Haute-Savoie, ainsi que des régions situées le long des côtes méditerranéenne et atlantique, où les prix atteignent des niveaux particulièrement élevés (figures 8 et 9). Bien que les revenus bruts annuels y dépassent la moyenne nationale, la proportion de ménages ayant les moyens d’y accéder à la propriété reste plus faible qu’ailleurs (voir l’étude « Les prix des logements en propriété sont-ils abordables ? »).
Depuis 2022, la France connaît une hausse continue des loyers, qui s’est encore accentuée depuis 2023. L’indice des loyers du secteur libre a progressé de 1,3 % en 2022, puis de 1,8 % sur chacune des deux années suivantes (figure 10). Ainsi, en trois ans, les loyers ont augmenté de 4,9 %. Cette dynamique est d’autant plus marquante que l’inflation a nettement ralenti en 2024, pour tomber sous la barre des 2 % en fin d’année. Cette hausse des loyers est particulièrement prononcée dans l’agglomération parisienne, comparée au reste de la France métropolitaine (figure 11).
En 2023, le marché locatif a été particulièrement tendu. L’augmentation des coûts de financement a contraint de nombreux ménages, incapables d’acheter, à rester locataires. L’amélioration des conditions de crédit en 2024 et le retour progressif des acheteurs sur le marché n’ont pas suffi à apaiser les tensions, en raison d’un cadre réglementaire plus contraignant.
Des dispositifs de régulation dans les zones tendues (encadrement ou plafonnement des loyers), ont récemment été mis en place dans plusieurs villes : Montpellier et Bordeaux (juillet 2022), le Pays Basque (novembre 2024), la métropole grenobloise (janvier 2025). Ces contraintes viennent accentuer la baisse de rentabilité locative, notamment après le rétrécissement du dispositif Pinel en 2023 et sa suppression au 1er janvier 2025.
La loi Climat et Résilience de 2021 impose, à partir du 1er janvier 2025, l’interdiction de mise en location des logements classés G. Cette interdiction s'applique au moment d'une relocation ou d'une nouvelle location. Selon les périodes et les sources, le parc locatif privé en France connaît un taux de rotation annuel compris entre 18% et 25%. À une échelle pluriannuelle (par exemple sur 4 ans), près de la moitié des locataires du secteur libre ont déménagé au moins une fois (cf. les études de l'Insee Enquête Logement 2013 en 2017, de la Fnaim en 2014 et de Foncia en 2024).
De nombreux propriétaires, ne disposant pas des moyens pour effectuer les travaux nécessaires, pourraient ainsi être contraints à retirer leur bien du marché. Cela concerne 567 000 logements, soit 7 % du parc locatif (7,7 millions de logements). L’impact est clair : l’offre locative diminue dans un contexte où la construction est en berne depuis plusieurs années - le nombre de logements collectifs autorisés est à son plus bas niveau depuis 10 ans (figure 2).
L’interdiction à la location des logements énergivores pourrait accroître le nombre de logements vacants, en particulier dans des zones à faible attractivité, où les prix et les loyers sont trop bas pour rendre les rénovations rentables (voir l’article « Les classes DPE et ses effets sur les prix et loyers des logements »). Selon l’Insee, la France comptait plus de 3 millions de logements vacants en 2024. Ce chiffre est en hausse en 2024, tiré par la vacance dans le logement collectif (+1,5 %, figure 12). Une partie significative de ces logements est vétuste ou située dans des zones peu attractives.
Au 1er janvier 2023, selon le Service des données et études statistiques (SDES), 1,5 million de logements locatifs étaient classés F ou G, soit 18 % du parc. Si les logements classés F sont à leur tour interdits à la location à partir de 2028, l’offre locative pourrait fortement reculer, en particulier dans les grandes villes et zones étudiantes. Dans les villes étudiantes comme Bordeaux ou Grenoble, où les petites surfaces énergivores sont nombreuses, les loyers des studios rénovés pourraient fortement augmenter, accentuant les inégalités d’accès au logement, notamment pour les ménages et étudiants modestes. Le plafonnement des loyers, déjà en place dans ces villes pourrait toutefois limiter cette hausse.
Dans ce contexte de tension croissante, les loyers ont progressé de 1,8 % entre janvier 2024 et janvier 2025, malgré la régulation dans certaines zones tendues. L’augmentation est de +4 % à Paris et Bordeaux, +3 % à Montpellier, +2 % à Lille et Lyon - toutes des villes ayant déjà mis en place l’encadrement des loyers (figure 13). La hausse est toutefois plus marquée encore à Marseille et Strasbourg (+6 %), où l’encadrement n’est pas encore appliqué. Marseille a d’ailleurs déposé une demande pour expérimenter cette mesure en 2025-2026, en réponse à la pression croissante sur son marché. L’encadrement des loyers ne bloque pas les hausses, mais fixe un plafond à ne pas dépasser à la signature d’un nouveau bail, selon l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Dans un marché où la demande reste forte et l’offre limitée, même encadré, le marché continue d’augmenter.
Au 1er trimestre 2025, selon Wüest Partner, le loyer mensuel médian de l’offre pour un appartement de 3 pièces en France métropolitaine s’élevait à 12 euros le m2 (voir encadré méthodologique). Mais la répartition est très inégale selon les territoires : seuls 17 départements sur les 96 analysés de France métropolitaine dépassent cette moyenne nationale. On retrouve les départements de l’Ile-de-France avec Paris (29,6 euros/m2, +4 % sur un an), des Alpes-Maritimes (17,4 euros/m2, + 3 %), de la Haute-Savoie (15,5 euros/m2, +5,1 %) et des Bouches-du-Rhône (14,1 euros/m2, +1,8 %) où les prix à la location sont les plus élevés du pays. À l’inverse, les loyers sont beaucoup plus abordables (24 % inférieurs à la moyenne nationale) sur 30 % du territoire représenté par une large bande qui s’étend du sud-ouest au nord-est (Haute-Saône : 6,1 euros/m2, Cantal : 7,8 euros/m2, Ardennes : 8,1 euros/m2, Corrèze : 8,5 euros/m2, figure 14).
Même si la crise de l’immobilier ancien semble se résorber, grâce à l’amélioration des conditions de financement qui encouragent davantage de ménages à acheter plutôt qu’à louer, le marché locatif reste très tendu. L’interdiction de mise en location des passoires thermiques contribue à aggraver la situation de l'offre sur le marché locatif qui est déjà sous pression par le blocage du marché de la construction. La pénurie devrait perdurer à court terme dans les zones tendues.
Paradoxalement, cette situation accroît aussi le risque de vacance, notamment dans les zones rurales ou peu attractives, où les logements sont souvent énergivores et donc interdits à la location, sans perspective réaliste de rénovation. Selon les estimations de la Fnaim, la rénovation du parc locatif privé classé F et G nécessiterait près de 100 milliards d’euros. Le marché locatif français continuera donc de faire face au double défi de la transition énergétique et de la relance de la construction.
Fédération Nationale de l'Immobilier (Fnaim), Figaro immobilier, Insee, Notaires de France, Notaires du Grand Paris, Observatoire Crédit Logement / CSA, OCDE, Service des données et études statistiques (SDES), statistiques.developpement-durable.gouv.fr,